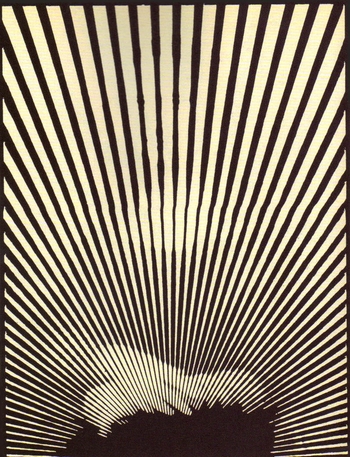-
Le jour. Non pas un jour comme on pourrait communément se l’imaginer. Le jour, gris, sombre, oui. Ce jour maussade et triste qui rend les choses fades. Les nuages. Formes disgracieuses se laissant porter par un vent quelconque et s’étalant dans le ciel. La fenêtre. Par laquelle s’offrait tout ce spectacle morose.
- Viens donc t’asseoir prendre le thé plutôt que de rester planter devant ta fenêtre. Tu y passes déjà assez de temps.
- Sans doute.
- D’ailleurs, as-tu vu le facteur passer ?
- Sûrement. Pas de souvenir.
- Eh bien j’irai regarder ça tout à l’heure. Tiens. Le sucre. J’ai encore oublié de prendre les cuillères. Tu as vu, Gervaise a donné naissance à deux jolis garçons. Je me demande qui est le père.
- Gueule-d’or, c’est sûr.
- Comment peux-tu en être aussi certain ? C’est ton copain Gueule-d’or ? Et puis arrête de l’appeler comme ça, veux-tu !
- Tes deux bambins bessons, ils sont blonds comme les blés. C’est cousu de fil blanc. Je l’ai bien cerné moi ce Gueule-d’or ! Il parle pas beaucoup, ça non. Muet qu’on pourrait croire. Il chante, c’est tout. Ça plaît aux femmes. Voilà comme il s’y prend !
Le silence. Un moment.
- Pourquoi es-tu si pensif ? Quelque chose ne va pas ?
- Je repensais juste à ce pauvre Albert. C’est tragique.
- Oui, terrible accident, n’est-ce pas ?...
- Oui, oui… Seulement… Je me souviens de ce qu’il me disait, il y a maintenant quelques années. Tout ce qu’on a essayé de combler pour s’en sortir, ce fossé infernal, on n’est jamais parvenu à le boucher. C’est vrai, maintenant je m’en rends compte : je m’imaginais que le monde était à moi, je le tenais bien dans ma main. Désormais, ce n’est plus que de l’eau qui coule, insaisissable. Tout ce que j’ai appris pour m’assurer d’être bien là, en chair et en os ; tout ça n’était que belle poésie en fin de compte !
- Qu’est-ce que tu racontes ? C’est absurde !
- C’est bien ça le problème, tout est absurde.
- Oh, arrête un peu. Tu te fais vieux voilà tout.
- Peut-être.
Dehors, le vent se levait et de fortes bourrasques ébranlaient la maison. La complainte du vent passant par les joints usés de la fenêtre renforça cette atmosphère lugubre qui s’installait.
- Je vais me coucher.
- Déjà ?! Il ne fait pas encore nuit !
- C’est tout comme.
- Tu ne finis pas ta tasse ?
- Qu’est-ce que j’en ai à faire ? Rien n’est fini, tout est à refaire. Laisse-moi, je suis fatigué.
Le croassement d’un corbeau.
- Bonne nuit…
Pas de réponse.
Nicolas
 votre commentaire
votre commentaire
-
Où suis-je ? Pourquoi ? Comment ? Tant de questions sans réponses… Vous êtes-vous posés ces énigmes existentielles qui vous taraudent l’esprit ? Elles me hantent tous les jours… Particulièrement en ces sombres soirées d’automne qui ont le mauvais goût de vous saper le moral. Shakespeare nous disait que la vie n’était qu’une ombre en marche, un pauvre acteur qui s’agite pendant une heure sur la scène, qu’elle n’était qu’un récit conté par un idiot, plein de son et furie, ne signifiant rien. Une superficialité qui nous gouverne en somme. On se bat pour elle, on meurt pour elle, tout cela pour des rêves et des envies soudaines ; des volontés qui nous dépassent parfois. Allons de l’avant, battons-nous, vivons et refaisons le monde ! Il y a tant de choses à faire et à défaire. Tant de conflits à résoudre, tant de dilemme… Seulement, la dernière note de la mélodie semble bien amère. Sans lendemain. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi !? Moi qui suis si faible, pourquoi !? Me répondras-tu enfin à ces questions sans fin ? Où en suis-je ? Perdu dans un univers de folie sans doute. A l’aide ! Au secours ! Que quelqu’un me réponde ! Le silence… Il n’y a que cela qui puisse m’entendre. Je ne vois aucune autre réponse. Où sont les belles utopies d’antan ? Les larmes sont mon seul réconfort, la nostalgie ma seule accroche.
Adieu, je vous aime malgré tout le mal que vous m’avez fait. Je vous aime autant que vous m’avez fait souffrir. Terrible ténèbres, serez-vous les seuls êtres que je côtoierai avant cette fatalité ? Ai-je tant causé de mal autour de moi pour ça ? Est-ce le châtiment de tout mon égoïsme et de mon orgueil ? La peur et le remord me hantent. Je n’en puis plus. Au diable tous ces rêves idylliques qui me semblaient réalités ! Je ne mérite rien. Ni vos consolations, ni vos conseils, ni vos caresses, ni vos pleurs et vos désirs. Je ne suis qu’un fou qui gémit à l’agonie, rien de plus.
Allez-vous-en ! Partez chimères de mon esprit, de mon cœur et de mon âme ! Toutes ces promesses qui s’évaporent… Envolez-vous vers Dieu, vers Satan ou vers qui vous voudrez, mais par pitié, ne me hantez plus.
Ne m’en voulez point de cette plaidoirie pathétique et pitoyable. Je ne suis qu’une âme faible dans un monde qui me happe et me détruit. Laissez-moi en paix, c’est tout ce que je vous demande. Et quand bien même vous me laisseriez, je serais toujours malheureux. Idéal irréalisable… Que faire ? Rien ? Ce serait trop facile…J’ai froid, si froid… Je marche dans cette rue à peine éclairée, seul. Je trébuche, je vacille. Je tombe dans cet abîme sans fin, cherchant désespérément une main à laquelle me raccrocher. Il est trop tard. Un instant, j’ai cru aimer vivre.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Je fais souvent ce rêve… Un rêve doux et âpre. Un rêve qui pénètre ma pauvre âme meurtrie. Un rêve qui n’est ni jamais tout à fait le même, ni réellement un autre. Un rêve empli de mélancolie et de remords.
Le jour tombe. Je me tiens face à une mer calme, d’une grandeur infinie et merveilleuse. Les agonisantes lueurs rougeâtres de l’horizon me rappellent un certain automne, triste et plein de nostalgie. Une tendre brise me caresse le visage, à la manière réconfortante d’une mère qui exprimerait tout son amour pour son enfant. Je suis heureux, oui, heureux d’avoir suivi le soleil tout au long de sa course ; satisfait d’une journée menée à son terme et d’un repos solennel qui s’annonce. Demain sera un autre jour comme celui-ci, plein d’agréables surprises et de moments magiques ; plein de force et de vigueur, de volonté et de courage. Il est vrai que cet instant est imprégné d’un soulagement sans précédent. Le crépuscule me délivre de cette angoisse sourde de la vie et du temps. Cet état d’engouement me donne la force de soulever chaque montagne du continent, je suis déjà prêt à faire face au monde entier.
Seulement… Seulement, le soleil couchant a déjà disparu de mon champ de vue et les ténèbres de la nuit noire viennent aspirer tout mon Être. En quelques secondes, tout a été happé par les terribles ombres. Ne reste plus que la lumière blanchâtre de la Lune, cette effrayante Lune que je redoute par-dessus tout. Déjà, elle m’enveloppe de son atmosphère phosphorique et m’imprègne de ses couleurs pâles. Elle me fait comprendre que je ne suis qu’à Elle, m’enlace dans ses bras froids et me donne le baiser fatal. Puis, elle me murmure à l’oreille à la manière des clapotis de l’eau : « Tu n’aimeras que moi, mortel oisif, tu resteras à jamais dans ma douce étreinte. »
Sa voix m’a séduit. Je me laisse faire docilement face à ses minauderies. Si j’avais été chat, j’aurais ronronné affectueusement et me serrais frotté contre sa peau blanche et douce. Mais, dans un dernier élan de lucidité ou de folie, je la repousse sans explication. Hélas, ce fut sans doute la dernière chose à ne pas faire. Vexée, la jalouse Créature se met à me serrer délicatement à la gorge. Une profonde tristesse m’envahit alors. Je savais que je ne pourrais plus enlever cette envie de pleurer qui venait de me saisir. Les yeux plein de larmes, je me mis à la regarder et elle me dit, comme pour répondre à ma détresse : « Ainsi soit-il. Tu as choisi de refuser l’avance de ta plus jolie amante. Tu subiras donc mon éternel châtiment. Profite une dernière fois de ma tendre étreinte. Désormais, tu m’aimeras pour toujours mais en vain ; tu aimeras cette mer immense sans jamais en voir la fin ; tu aimeras la vie sans jamais la savourer ; tu aimeras tous ceux qui m’ont refusé sans jamais les comprendre. »
Ô terrible astre, sauras-tu un jour me pardonner pour que je puisse chasser cette irrésistible envie de te revoir ?
Nicolas
 1 commentaire
1 commentaire
-
A-t-on déjà connu un silence aussi profond que celui d'un public qui attend la première note de l'orchestre ? Il faut croire que non. Tout le monde retient son souffle, il n'est pas question d'éternuer ou de tousser sous peine d'être haï par toutes les personnes qui vous entoure. Puis, tout doucement, le premier sifflement monte et vous soulage de l'attente. Très vite, il est suivi par un deuxième, troisième, dixième, vingtième autre sifflement venu d'horizons différents. Ils vont et viennent à leur gré mais toujours de façon progressive. Pas de brusquerie, il ne faudrait pas briser cette douce continuité. Rond, rond, ainsi sont les notes et accords. Vous courbez l'échine pour mieux vous faire caresser. A votre tour vous devenez rond, bulle, léger, flottant au-dessus de tout. Déjà, la concentration s'échappe au lyrisme de l'instant. L'esprit s'envole, le temps n'a plus de prise, seule la dimension de la mélodie est prise en compte. Cette dimension inconnue et insaisissable n'a jamais été aussi proche. Vous nagez dedans, ou peut-être préférez-vous vous laisser porter par le courant, c'est naturel et régulier. Je pense sans vraiment penser mais voilà que le silence retombe, doucement, pareillement à la mélodie. L'harmonie aura duré du début à la fin. Comme pour le silence initial, il faut attendre que la dernière note tenue disparaisse dans le Néant avant de pouvoir applaudir.
En vérité, il existe plusieurs façons d'écouter un morceau. D'une manière globale comme précédemment, à savoir considérer le Tout, l'ensemble des parties sans en laisser une en retrait. Une vision, ou plutôt une écoute, plus légère, presque frivole mais qui n'en reste pas moins belle. L'autre, à l'inverse, plus discrète, qui cherche à identifier le particulier, l'élément qui dénote et émerveille. L'analyse précise de la partition d'un instrument isolé au sein de l'orchestre tout entier. Pas seulement les solistes qui se montrent en avant, mais aussi la rythmique, celle qui structure et pose le décor. Tambours, cymbales : ils marquent le temps invariablement et cadrent leurs camarades plein d'ardeur. Et puis les basses ! Mes favorites ! Celles qui viennent faire le lien entre rythmique et mélodie. Toujours très carrées et rigoureuses. A chaque temps, à chaque coup, elles seront présentes, remplissant le vide autour d'elles. Voyez le creux qui s'instaure sans elles ! Leur absence nous rappelle leur légitimité dans l'ensemble.
Je digresse, je digresse. Voilà la deuxième partie du concert qui commence sous la baguette bienveillante de notre chef d'orchestre coréen. Il a invité son ami le Dragon Doré, joueur magistral du sheng, un bien drôle instrument à vent. Il se place au-devant de tous, habillé de noir et d'or, attendant le signal avec sa cornemuse asiatique au bec. Il finit par se lancer, seul, puis les violoncelles le suivent au fur et à mesure. Il a l'air de bien s'entendre avec tous, c'est ce qu'on se dit de prime abord. Puis, très vite, on se rend compte que le tonnerre gronde au loin et se rapproche vers notre pauvre Dragon esseulé. Le déluge commence et s'abat sur la scène. Un vrai branle-bas de combat ! Le Dragon ne se laisse pas avoir aussi facilement : il esquive, virevolte, danse à chaque éclair qui frappe. Ensuite, c'est la pluie qui tombe en trombe. Mais notre ami doré ne s'en fait pas pour si peu et continue joyeusement sa mélodie. Et il continuera jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle contre vents et marées, contre les armées déchaînées, contre l'oubli de son chant. Et ce combat, il l'aura mené en gardant l'harmonie de toutes choses.
Une fois dehors, je regardai le ciel dans l'espoir de revoir passer ce fier être. Je me rendis très vite compte que j'attendais en vain, que toute cette féérie ne faisait qu'habiter mon esprit. La musique m'avait envoûté et empli d'émotions. On m'attendait tandis que je flânais. Je rejoignis tout le monde, le coeur léger : le chant du dragon résonnait en moi.Nicolas
 3 commentaires
3 commentaires
-
La première fois est un mimétisme. Voilà ma conclusion ! A chaque chose que l'on rencontre pour la toute première fois, nous adoptons une attitude instinctive visant à pallier notre inexpérience. Moultes personnes ont sans doute déjà eu des pensées similaires. Ce n'était pas tant la finalité de cette idée qui me satisfaisait mais plutôt le cheminement de mon raisonnement.
Je déambulais à cet instant précis sur Haight-Hashbury, lieu où les idées fusent de toutes parts mais également lieu où elles disparaissent tout aussi vite. Malheureusement, je n'échappais pas à ce deuxième point. Envolé beau raisonnement ! Pschht ! Idées trop légères qui s'élèvent... Ah ! Non ! Je les aperçois là-haut ! Hop ! Les revoilà, je les tiens bien cette fois-ci.
Où en étais-je ? Le mimétisme de la première fois... Cela m'est venu du fait de ce deuxième voyage à San Francisco. Le premier voyage c'est avant tout la confrontation entre la réalité et l'imaginaire, ce que l'on découvre et ce à quoi on s'attend (parfois en vain) à voir. Et c'est de cette confrontation que naît le mimétisme, mimétisme du touriste en l'occurrence. Chez soi, il n'y a plus ou presque pas de confrontation possible entre la réalité et l'imaginaire puisque l'on sait à quoi s'attendre. Mais lorsque l'on voyage, le mimétisme intervient malgré nous pour nous rassurer, nous donner des repères en contrepartie des habitudes perdues. On joue au touriste banal, on prend des photos souvenirs, on va aux endroits dits "touristiques" où l'on retrouve nos semblables : amoureux de la photo classique du Golden Gate Bridge. Bref, on mime la forme du moule dans lequel on est tombé.
Grisé par cette pseudo-théorisation d'un phénomène social, je décidais alors de généraliser cette pensée pour expliquer notre comportement devant tout fait nouveau : mimer ce que l'on connaît pour mieux s'adapter. Je me suis rendu compte par la suite que je faisais en grande partie référence à René Girard et sa théorie du désir mimétique, théorie dont j'avais déjà entendu parler et que j'avais oubliée.
Mais revenons à ce deuxième voyage, il me fallait quitter ce mimétisme de la première fois dont je commençais à être lassé. J'avais mes repères, mon expérience passée, mes préférences... Il s'agissait maintenant de sortir du moule de simple touriste imitant ses confrères et agir en tant qu'entité à part entière. La ville s'ouvrait à moi et n'attendait plus que je puisse m'imprégner pleinement de tel ou tel quartier plutôt que des tous les survoler de façon superficielle.
Soudain, on me tire de mes pensées. C'est ce cher Deudé. Un sacré numéro celui-là encore ! Pour faire court, je ne sais de lui seulement qu'il est né au Congo et qu'il est venu à San Francisco en bateau. Ex-accro au crack, il passe la plupart du temps à flâner dans le Golden Gate Park en essayant de trouver la formule pour gagner au loto. Vous me direz quelle drôle de connaissance ! Et pourtant il m'a toujours paru doux comme un agneau.
"Oh ! Quelle heureuse surprise que vous vous teniez devant moi en cet instant !"
Je ne l'ai jamais entendu parler une autre langue que le français et sa langue natale, le kikongo. Après avoir prononcé ces paroles bienveillantes, il enlève sa veste de costume tachée par la boue, enroule sa manche autour de sa main droite, s'agenouille et me tend la main.
"Deudé !? Qu'est-ce qu'il t'arrive ?
- Je ne puis... vous serrer la main d'égal à égal... devant l'honneur de votre... éclatante blancheur intelligente... que votre présence m'apporte... à moi."
Il parlait de manière saccadée, cherchant ses mots à de nombreuses reprises. Gêné, je lui serre donc la main en lui demandant pourquoi il agissait de la sorte. J'appris que son éducation avait été marquée notamment par le respect jusqu'au déni de soi envers ceux qui avait apporté le "savoir" dans leur pays. C'est dans ces moment-là qu'on se rend compte à quel point l'éducation qu'on nous insuffle reste imprégnée dans nos mœurs et qu'il est extrêmement difficile de s'en séparer. J'avais beau dire et beau faire, il ne voulait pas démordre de son fichu respect presque trop caricatural.
Nous finîmes par nous quitter après mille révérences de sa part, chacun ayant à retourner à ses occupations. Je devais alors retrouver Tommy et July au Dolores Park. Chemin faisant, je passe devant Big Daddy, une sorte de parrain de la marijuana qui occupe le quartier. Pour une fois, c'était lui qui s'occupait des affaires. Il se tenait devant l'entrée d'un grand bâtiment, prêt à faire entrer les clients qui radinaient. Je pense qu'il n'avait pas choisi ce bâtiment par hasard : il se trouve juste à côté du McDonald's du croisement de Haight St et Stanyan St. Big Daddy comme son nom l'indique aimait se bâfrer à longueur de journée, à part ça on ne se sait pas trop... Il faut dire qu'il restait toujours stoïque, froid, voir presque menaçant dans sa façon de vous regarder. D'ailleurs, les clients qui venaient le voir n'en menaient pas large devant lui. Parfois ils tentaient d'être sympathique, un sourire par ci, une blague par-là, mais il restait toujours impassible et n'ouvrait la bouche seulement pour parler affaires. Malgré son tempérament, il n'avait jamais de problème pour vendre sa marchandise et attendait patiemment qu'on vienne lui acheter ses plantes vertes contrairement à tous les homeless qui vous interpellent à longueur de journée par des "buds" ou "mushrooms".
Quelques mètres plus loin, je tombe nez à nez avec deux junkies : l'un se bat contre un carton, l'autre me fait signe et me glisse un "follow me". C'est vraiment pas le moment ! Vite, je me faufile dans une boutique pendant qu'ils ne regardent pas. Plus de problème maintenant. Vous devriez vraiment aller dans ces boutiques. Tibetan Gift Corner, Happy High Herbs, Earth Song, Pipe Dreams, Land of the Sun, Cold Steel... Que d'ambiances folkloriques. Pour les amoureux du vintage, des fringues peace & love, des vinyles, des instruments en tous genre ou peut-être même de la fumette, on peut dire que c'est "the place to be"...
Je passe tout le tralala pour aller jusqu'au bus. Les arrêts passent : Cole St, Masonic Ave, Divisadero St, Castro St, Beaver St, 19th St. On se rapproche petit à petit du quartier mexicain, les esprits s'échauffent dans le bus, on ressent le sang chaud de certaines personnes. Ce qui devait arriver arriva : deux jeunes et un vieux commencent à brailler, se menacer, s'insulter...
"Come on Boys ! Go out the bus to talk with me !
- Shut up old man...
- Do you want to dance with me? I will shoot you !
- Fuck... grmgrm fucking.. blrbgm fuck..." finit par conclure le deuxième jeune, sosie mexicain de Big Daddy.
Au final, le Old Man a terminé de faire le forban dehors, faisant des doigts d'honneur à qui mieux mieux. A part ça, un trajet sans emcombres...
Church St, me voilà arrivé. Grand soleil, je retrouve Tommy et July dans un Dolores Park bondé de monde. Ça fait la sieste, ça fait du sport, ça vend des space cakes et des champignons, ça en consomme, ça vient de tous les horrizons : du chinois mafieux de Chinatown jusqu'au garçon en petite tenue du Moby Dick de Castro.
Après avoir flâner sous ce magnifique temps tous les trois en famille, on décide d'aller ailleurs. On approche de quatre heure, du monde commence à partir. J'interroge les personnes autour de nous.
"Well ! It's four twenny ! Amazing thing ! Come on !" qu'on nous dit.
Les américains ont cette fâcheuse habitude de ne pas prononcer le "t" dans twenty. Sur le coup je ne comprends pas et même après avoir tilté pour le "twenty" je me demandais toujours ce que c'était. Il est vrai qu'on était le vingt avril et puisque qu'ici on lit 04/20 pour la date contrairement en France, cela correspondait bien.
"Go to the Golden Gate Park ! At twenty past four !" ajoute quelqu'un d'autre.
Encore quatre vingt ! C'est décidé, on va voir ce que c'est !
Dans le bus, à nouveau une rencontre étrange. Il y avait une sorte de cow boy habillé tout en bleu ou violet (faut pas me faire confiance sur les couleurs, blindcolor comme ils disent), avec un chapeau énorme, de grossesRay Ban et une moustache imposante. Il était en train de nous regarder avec un peu trop d'insistance à mon goût. Mon cousin PA nous avait prévenu : pour eux les français sont des communistes. Il avait dû nous entendre parler ce faux shérif ! Bref, j'étais mal à l'aise. Mais très vite je l'oublie, dehors tout le monde klaxonne. Effectivement, il était quatre heure vingt. Les piétons poulopent en direction du parc. On descend à notre arrêt, on va voir ce qu'il se passe. Au loin, une foule immense, plus grande encore qu'au Dolores Park. Mais surtout un gros nuage de fumée s'élevant au-dessus des gens comme si le brouillard était tombé sur la ville. Déjà, les gens étaient goguenards et tout ébaubis à la fois. Ils se jetaient leur poudre magique verte dans la tronche, s'enfumaient les uns les autres à plus pouvoir respirer. J'aperçois Big Daddy et Deudé qui s'amusent ensemble comme deux gamins. Deudé chasse les piafs, se plaçant derrière eux, imitant leur démarche, bondit, rate, se roule par terre afin d'achever son costume. Notre gros dealer se fend la poire à le regarder. Le voilà qui souffle comme un taureau tellement il s'est bidonné. Mais pour une fois il est plus effrayant du tout : yeux écarlates, cernes démesurées, sourire benêt... C'est une première : Big Daddy s'amuse ! Personne n'y croyait plus. Le maître mot de cette fête est sans doute impulsivité. Big Daddy quitte Deudé pour la scène de rap plus loin encore. Dès qu'il l'aperçoit il se rue sur les spectateurs mollassons, saute, s'envole, écrase la foule. A son tour de se rouler par terre ! Il en bave tellement il est heureux.
" You know I really wanted to kill you amigo !"
Le vieux mexicain !
"Shut up old man ! Ahahah ! You're just a fucking crazy guy but I love you !
- Si señor ! Ahahah !"
Réconcilié avec les deux jeunes ! Ils se ramènent tous les trois bras dessus, bras dessous comme les meilleurs amis du monde.
Même le cow boy bleu est là ! Il danse sur du Daft Punk en hurlant "Damn it ! Vive la France !" Ah ! Le petit filou m'aura fait mentir.
Après avoir déambulé au gré des mouvements de foule, on rejoint Deudé et 2 fêtards. Ils étaient assis non loin d'une mini manifestation de 3 personnes qui condamnait cette fête au nom de Dieu. Ils étaient encadrés par quelques policiers. Ça n'empêchait pas les gens de rouler de gros pétards sous leurs yeux. La police ne bronchait pas non plus : c'était autorisé ce jour-là.
" Oh mais c'est l'homme léger !" s'exclama Deudé quand il remarqua ma présence.
Moi ? Léger ? Quel comble alors que je suis en train de lire L'insoutenable Légèreté de l'être ! Je ne savais que penser de ces propos. A mon tour, je suis rattrapé par les critères de Parménide. A qui attribuer le critère positif/négatif dans le couple léger/lourd ? Serais-je léger dans mon attitude à défaut d'être sérieux ? Ou bien au contraire serais-je quelqu'un qui arrive à se détacher des choses, qui a une vision plus globale grâce à la hauteur prise grâce à la légèreté ? A être trop léger, on a plus les pieds sur terre. Et pourtant, quand j'observe tous ces gens sous l'emprise de la marijuana, ils semblent accablés, écrasés par une pesanteur inconnue. Pour atteindre le paroxysme de la légèreté, pour que leur esprit s'envole et oublie tous les maux, le corps doit supporter le poids de cette légèreté en contrepartie...
Mais revenons à nos moutons. Deudé nous fit tous nous asseoir pour nous déclarer solennellement :
"Mes amis, nous voilà tous les six réunis. Il est six heures et j'ai réussi à trouver les six numéros gagnants du loto !"
Effectivement, il était 18:00 à ma montre. Drôle de coïncidence tous ces six, cela m'intriguait.
"Quand j'aurai gagné, je vous inviterai tous sur mon yoat ! J'en suis certain ! Le soleil que j'appelle Père décline derrière vous et vous illumine de sa clarté. Pour vous remercier de votre présence j'ai un présent pour vous."
Il se met alors à arracher les boutons de son costume et nous en donne un chacun. Puis il devient très sérieux tout d'un coup. Il veut quelque chose en échange. Il l'exige ! Il a besoin d'un crayon pour poursuivre son raisonnement sur son carnet. Son "savant" calcul n'aura servi à rien sinon ! Les autres ne bronchaient pas, sans doute n'en ont-ils pas. Je finis par me décider et lui tends un crayon.
"Oh ! Toi !?" s'écria-t-il.
Il s'agenouilla et me dit mille fois merci presque en pleurant, n'osant prendre le crayon de mes mains. Je finis par le lui poser à côté de lui. Nous le quittâmes tout de suite après. Il nous dit au revoir à sa façon :
"Merci ! Et désolé pour les oiseaux..."
Six oiseaux volaient au-dessus de nos têtes.
Il faisait nuit à présent. Nous étions toujours dans le Golden Gate Park mais cette fois-ci nous étions seuls. Tout le monde était rentré après la fête, le parc avait fermé. Plus précisément nous étions dans le Botanical Garden. Nous nous y étions réfugiés car les Cops rôdaient. Une vaste étendue de verdure s'offrait à nous. Au loin, on entendait les sirènes de police et de pompiers, ces derniers toujours à l'aguet d'un éventuel incendie, la bête noire de San Francisco. Le brouillard commençait petit à petit à tomber sur la ville. Comme on dit à San Francisco, après le beau temps, le fog !Nicolas
 votre commentaire
votre commentaire